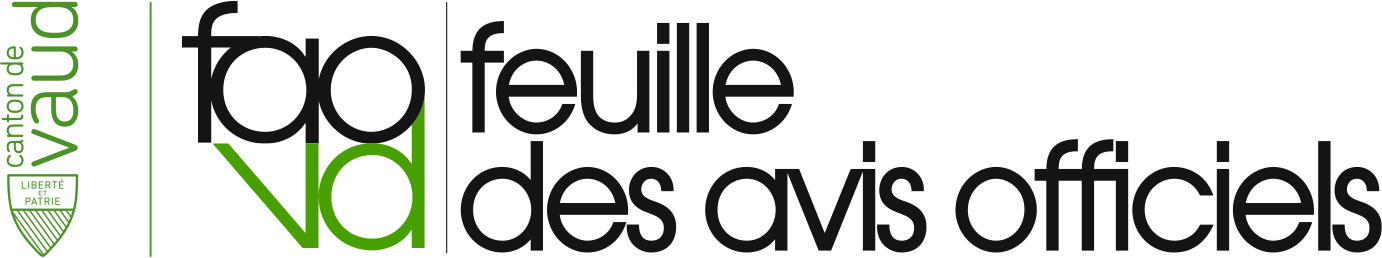Contrairement à ce qu’on aimerait croire, la pratique de la gymnastique ne remonte pas aux vieux Suisses et à la pierre d’Unspunnen. En revanche, on sera surpris d’apprendre comment elle a contribué à la construction de la Suisse moderne, mais aussi à la naissance des États-nations. Étudiant le phénomène du sport et de la tradition, l’historien Gil Mayencourt en a fait l’objet d’une passionnante thèse dont il nous retrace les grandes lignes.
«Il faut remonter au début du XIXe siècle pour voir la gymnastique importée dans l’espace helvétique par des réfugiés allemands qui, fuyant les persécutions, trouvent refuge dans les cantons libéraux. Le mouvement des Turnvereine (clubs de gymnastique) est codifié par Friedrich Ludwig Jahn, un patriote qui considérait que l’éducation physique était essentielle pour endurcir le caractère et développer le sentiment d’appartenance nationale. «Ce pédagogue allemand va ainsi conceptualiser une gymnastique, non pas pour l’individu, mais à l’échelle du collectif, du peuple et de la nation, explique Gil Mayencourt. Pour Jahn, cette pratique visait à éduquer le peuple allemand à l’idée de la guerre, mais aussi à la démocratie. Raison pour laquelle cette pratique était alors considérée comme libérale. D’autant plus qu’elle s’adressait à des milieux plutôt élitistes, essentiellement des cercles étudiants regroupés en associations.» Ce transfert culturel depuis les États allemands est à l’origine des premières sociétés de gymnastique helvétiques qui voient le jour entre 1810 et 1820, à Berne, à Zurich et à Bâle.
Une démonstration politique
La première Fête fédérale spécifique à la pratique gymnique est organisée en 1832 dans l’idée de fonder la Société fédérale de gymnastique (SFG). L’événement compte environ 60 participants, tous alémaniques. «La Fête se fait encore dans une perspective libérale, voire radicale, qui annonce la Suisse moderne. En voulant créer quelque chose de supracantonal, on peut parler d’une démonstration politique militant pour un État central et des droits démocratiques étendus, pas seulement à un groupe d’élite éclairé, mais pour tout le peuple masculin.»
Dans ses débuts, la gymnastique suisse est ainsi imprégnée d’une culture politique radicale. «Il est d’ailleurs intéressant d’observer comment, au fil du 19e, on passe d’un courant très progressiste à quelque chose de plus conservateur, avec un passage d’un patriotisme républicain à un nationalisme plus dur et identitaire. Pour résumer grossièrement, cela peut s’expliquer en partie par l’apparition d’un «ennemi commun pour les catholiques-conservateurs et les libéraux-radicaux, comme une réaction à l’émergence de l’internationalisme des mouvements ouvriers.»
Comment la Fête fédérale est-elle passée d’une manifestation dont la participation était confidentielle à un événement de masse? «Jusqu’en 1874, la Fête se tient chaque année, parce que la jeune SFG couplait une compétition et son assemblée générale. Parallèlement, on se rend également compte qu’il y a beaucoup trop de fêtes en Suisse, tous domaines confondus: les tireurs, les chanteurs, les fêtes cantonales… Aussi, est-il décidé de les espacer dans le temps et ainsi réduire le nombre de fêtes. « Et quand on laisse passer plus de temps, forcément, l’attente est plus grande.»
Mais de nombreux autres facteurs expliquent cet engouement. «D’abord des raisons démographiques ; la population augmente, les sociétés de gymnastique se multiplient à travers le pays. Ensuite, le développement du chemin de fer permet de rendre les Fêtes plus accessibles. Enfin, la pratique de la gymnastique s’est répandue dans la population, elle devient de plus en plus populaire. Et puis, c’est aussi la Belle Époque, durant laquelle on assiste à la montée en puissance de la bourgeoisie et d’une amélioration de son pouvoir d’achat. Dans un esprit festif, le public vient voir des spectacles, des galas, mais aussi boire, à manger.» Le cap des 1000 participant est franchi en 1870. Puis il ne fera que croître…
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la SFG prend activement part à la défense spirituelle: «Un phénomène observé en Suisse depuis les années 1930, qui correspond à une réaffirmation des valeurs traditionnelles et nationales, couplée à une lutte culturelle contre la montée des totalitarismes. Très proche des gymnastes, le général Henri Guisan les définissait comme son armée blanche en faisant référence à leur uniforme.»
Un bastion masculin
À ses débuts, la Société fédérale de gymnastique est un bastion masculin. «Et encore, elle ne s’ouvre que très progressivement. Certes, les premières sociétés de gymnastique féminine existent depuis la toute fin du 19e siècle, et elles ont peu à peu leur calendrier propre, mais elles sont très encadrées par des hommes. Et, officiellement, il n’y a pas de compétition, pas de remise de récompense: «Parce que la compétition, c’est réservé aux hommes, c’est viril, c’est se mesurer l’un à l’autre. Alors que pour les femmes, la gymnastique doit être, selon les hommes qui pensent la pratique, plus douce, plus hygiénique. De plus, elle est très codifiée, notamment sur les tenues. Il faut attendre 1984 pour que la Fête fédérale de gymnastique intègre officiellement les femmes et devienne un événement pleinement mixte, où les disciplines et compétitions sont ouvertes aux gymnastes des deux sexes.
Sortie au mois de mai 2025: «Faire nation en faisant de la gymnastique, Une histoire culturelle et sociale de la Société fédérale de gymnastique (1853-1914)», 608 pages, éditions Alphil, Neuchâtel.